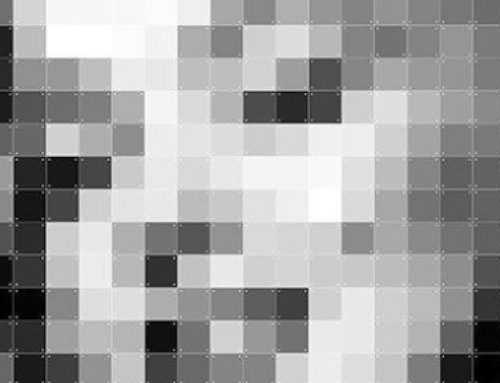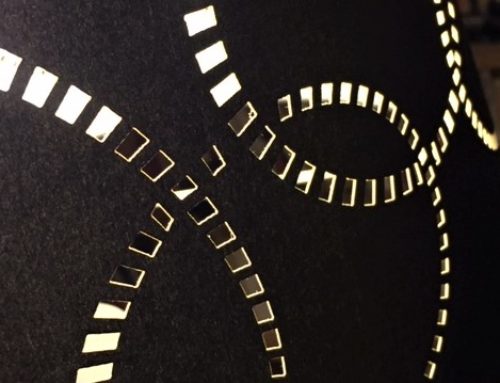Les dernières peintures de Johanna Perret présentées à l’Arteppes (Annecy) cet automne fonctionnent comme des pièges pour le regard. Le spectateur peut passer à côté sans les voir, du moins sans les voir réellement. Sous l’attention distraite de regardeurs pressés, elles ressemblent à des monochromes sensibles dont la couleur affiche des modulations. Monochromes habités, qui rappellent les peintures de Rothko tout autant que les photographies de Sugimoto pour leur rapport à l’essentiel.
A y regarder de plus près ces vibrations colorées masquent et montrent à la fois des formes ténues, presque absorbées par la matière picturale, aux contours précis mais ton sur ton, d’une délicatesse de valeurs qui traduit le talent de l’artiste à faire tenir ensemble le diffus d’un fond et la netteté du trait qui s’en dégage. Il en résulte une sensation d’atmosphère embrumée comme si l’air était chargé de particules infimes qui forment écran et filtrent la perception que nous avons des choses dans l’espace. Une fois saisie leur présence, nous n’avons d’autre choix que de nous arrêter pour en discerner la tournure et reconnaître ici une chaîne de montagne, là un pylône électrique, là encore de grands arbres émergeant du brouillard. Ces monochromes presque abstraits en deviennent figuratifs et la présence d’un paysage se révèle sous l’insistance du regard à suivre la ligne qui s’enfonce peu à peu dans la couleur. Le sujet résiste à sa disparition progressive dans la matière colorée qui menace de l’engloutir. Le spectateur est ferré ! Sa déambulation dans la salle d’exposition est interrompue. Il s’arrête, avance, recule, se déplace vers la droite puis vers la gauche pour saisir mieux, en essayant tous les angles, ce que la surface et ses légers reliefs trahissent de la composition. Ce qu’il découvre alors ne lui donne pas encore toutes les clefs du mystère…
Les peintures des séries Lux Nova et Fantômes semblent jouer des ressorts d’un éclairage artificiel savant alors qu’elles ne s’appliquent qu’à reproduire le réel au plus près, à savoir la vallée de l’Arve et la chaîne du Mont-Blanc au moment d’un pic maximum de pollution. Il n’y a pas d’illusion, pas de filtre mystérieux transfigurant le monde, si ce n’est celui que la pollution installe entre nos yeux et ce qu’ils contemplent et dont l’artiste s’emploie à retrouver précisément la tonalité grise ou bleuté. Plusieurs valeurs de gris sont passées en fines couches successives pour créer profondeur et lumière. La couleur est appliquée en tapotant le pinceau sur le support afin de supprimer les traces du geste et les effets de matière. L’impression produite est toute d’évanescence. Johanna Perret inventorie précisément les sommets dont elle saisit les silhouettes avalées par l’écran opaque d’un air dégradé. Ce faisant elle prend acte d’un état des lieux que l’avenir compromet.
Les titres Lux Nova, Hécate ou Fantômes, en faisant référence à un passé néo-gothique, à la mythologie grecque ou à quelques fantasmagories, évoquent plus des réminiscences mystiques ou symbolistes que la réalité dont les œuvres témoignent. Le décalage nous plongerait facilement dans l’univers spiritualiste du XIXème siècle. Un romantisme noir qui touche à la fois la littérature et les arts et met à l’honneur une esthétique nocturne de clair de lune propice à la déambulation des revenants ou au sabbat des sorcières. Les angoisses humaines y sont concentrées dans des scènes de violence, de tristesse ou de mort. Quelques œuvres du passé nous reviennent en mémoire, voilées de nostalgie. La procession dans le brouillard d’Ernst Ferdinand Oehme[1] qui met en scène un premier plan sombre mais net allant en s’éclaircissant vers le fond mais absorbant ce faisant les contours des arbres et la colonne humaine qui s’enfonce dans le gris ouaté. Ces mêmes arbres dépouillés et tordus, dont le bois noir à peine perceptible dans le fond brun de la partie basse se détache nettement sur le ciel plus clair, encadrent le pan d’une architecture gothique en ruine dans Abbaye dans une forêt de chênes[2] de Caspar David Friedrich. Ou encore Digue la nuit, Reflets de lumière[3], ce tableau de Léon Spilliaert que l’économie de moyens réduit à des masses sombres aux contours flous, à des points et à des lignes verticales lumineuses.
Si l’on s’attache à la grande précision de rendu, au lissé et au brillant de surface des toiles de Johanna Perret, c’est à la photographie que l’on pense plutôt qu’aux peintures atmosphériques d’un Turner qui opposent au sujet la réalité d’une matière picturale affirmée. Mais l’objectif de Johanna Perret n’est pas de rendre en peinture un effet proprement photographique à l’instar de l’usage du noir et blanc et du flou qui inverse les rapports mimétiques entre peinture et photographie dans l’œuvre de Gerhard Richter, il est de faire croire à une sublimation du réel alors que l’on contemple une réalité polluée. Ces « vues » rappellent étrangement des daguerréotypes dont les matériaux se sont altérés à l’instar de ce paysage de montagne attribué à Dardel et conservé au Musée de l’appareil photographique de Vevey dont l’image apparait rayée et ternie en surface, comme envahie par une brume.[4] Certains photogrammes du Faust de Murnau[5] organisent la composition autour d’un halo lumineux central, une aura qui peine à s’imposer devant les ténèbres qui gagnent la périphérie. Ici ce ne sont pas les lignes des massifs montagneux mais des silhouettes à peine humaines, celles de branches et de ruines qui percent à contre-jour pour produire un effet menaçant.
Le passage du gris au bleu s’opère progressivement dans la série Fantôme mais s’affirme véritablement dans la série Hécate. Egalement liés au changement de sujet, l’augmentation notable du format des toiles et le choix de la verticalité après l’horizontalité. La typologie des thèmes est toujours associée à un format particulier : horizontal pour la montagne – le format paysage dans ce cas précis va de soi – vertical pour les arbres et la forêt, après une transition par le format carré pour les éléments de paysages urbains (pylônes électriques, ponts d’autoroute etc…). Elle est aussi associée à une gamme chromatique et ce non seulement dans les peintures mais aussi dans les dessins comme on le verra plus tard avec les Scènes de Jouy, Scènes de joui.
Hécate, déesse de la lune préside donc à ces représentations nocturnes. Est-ce la pollution ou l’aube tout juste naissante qui donne cette densité à l’air lui ôtant toute transparence ? Les grandes toiles au bleu de Prusse absorbent le tronc des arbres dont on devine la présence prise dans quelques zones de lumière verdâtre obtenues par l’ajout de doré. Contrairement à ce que l’on a souvent dit de la peinture, les tableaux de Johanna Perret ne se donnent pas d’un seul coup d’œil. Seul le déplacement permet de les saisir dans toute leur complexité. Il faut s’approcher de la peinture et affronter une profondeur apparemment sans repère pour en discerner les détails. Prendre le risque de s’y perdre. Le projet est bien d’attirer le spectateur, de le placer dans l’orbe de la couleur puis d’envahir son champ visuel afin qu’il soit immergé dans cet espace sans sol et sans bords. Le Nocturne au parc royal de Bruxelles de William Degouves de Nuncques[6] génère un peu cette même impression de lumière bleutée mais l’éclairage artificiel qui troue de part en part la surface et le damier régulier du parterre où alternent carrés de pelouse et chemins stabilisent la composition par le bas et offrent des points d’ancrage rationnels. L’inquiétude qui se dégage là est d’une certaine manière maîtrisée. Cette même dominante bleue envahit aussi l’espace des cyanotypes et fait se détacher en négatif la silhouette des objets exposés aux rayons ultraviolets. Mais si le sujet est saisi en retrait par ce procédé, donc absent et pourtant bien visible, ceux peints par Johanna Perret sont bien présents mais à ce point menacés dans leur perception qu’ils en deviennent presque invisibles.
Johanna Perret réussit à lier à la fois précision et flou. Elle flirte avec l’abstraction tout en restant profondément attachée à la représentation. Sa maîtrise technique révèle un art du dessin accompli dont elle fait preuve dans une de ses dernières séries à l’encre sur papier, Scènes de Jouy, qui allie naïveté et cruauté. Les scènes pastorales rendues célèbres par les motifs des tissus de la manufacture de Jouy en Josas à la fin du XVIIIème siècle prêtent ici leurs décors à des situations de torture. Là encore le leurre fonctionne. Celui qui regarde est tout d’abord attiré par le côté joli, précieux et décalé de la référence, mais une fois devant le dessin ce qui s’ouvre à lui n’a plus rien de léger. Toute l’ambivalence de ce travail éclate alors. Le maniérisme du style se heurte à la violence des images. Décapitations, démembrements, écartèlements, pendaisons… tout un inventaire de tortures qui trouvent leurs sources dans les images de presse défile sous nos yeux. Rien d’imaginaire là encore mais une réalité crue que la frivolité apparente ne fait que renforcer par son indifférence et sa légèreté. Jouer l’attraction d’abord et puis la répulsion. Dans la fête galante, glisser des atrocités.
Et l’histoire de l’art toujours qui tisse entre passé et présent un réseau infini de liens comme avec cet album de photographies de Charles-François Jeandel[7] proposant un répertoire de scènes de martyrologie à l’usage des peintres et dont la thématique autant que la teinte dominante n’est pas sans rappeler ces dessins. Tout comme, dans un autre registre, le style et les motifs des faïences de Delft reproduits sur des bouteilles de gaz par Wim Delvoye. En pendant, les Scènes de Joui exploitent les postures amoureuses à la manière d’un Kama Sutra désuet. Un catalogue d’accouplements plus pornographiques que bucoliques qui, en regard des Scènes de Jouy, renvoie inévitablement à Sade.
Le travail de cette jeune artiste prend en charge tout à la fois un héritage historique, un savoir-faire affirmé et un ancrage contemporain par le biais du détournement. L’essentiel réside peut-être dans le choix d’un temps d’exécution long à une époque de vitesse, de zapping et d’hyperactivité. Par ce mode de fonctionnement, elle installe une pratique de la peinture de nature méditative qui contraste avec sa propre nature vive et passionnée. En peignant elle se met dans un état cotonneux d’hypersensibilité qui la place hors du temps, dans un bain coloré dont elle module à l’envi les nuances et qui gagne et enveloppe le spectateur dans ce qu’elle appelle des « états d’être ». Mais la séduction qui se dégage de ses œuvres n’est pas exempte de danger. L’ironie réside dans le jeu de faux semblants qui court-circuite l’impression insouciante d’un style fleuri pour reproduire l’horreur et fait naître des gaz polluants un sentiment de transcendance.
[1] Ernst Ferdinand Oehme, Procession dans le brouillard, 1828, Galerie Neue Meister, Dresde.
[2] Caspar David Friedrich, Abbaye dans une forêt de chênes, 1809-1810, Staatliche Museum, Nationalgalerie, Berlin.
[3] Léon Spilliaert, Digue la nuit. Reflets de lumière, 1908, musée d’Orsay, Paris.
[4] Gustave Dardel ?, Paysage de montagne, vers 1849, daguerréotype, Musée suisse de l’appareil photographique, Vevey.
[5] Friedrich Wilhelm Murnau, Faust, une légende allemande, 1926.
[6] William Degouve de Nuncques, Nocturne au parc royal de Bruxelles, 1897, musée d’Orsay, Paris.
[7] Charles-François Jeandel, album de photographies, 1890-1900, musée d’Orsay.