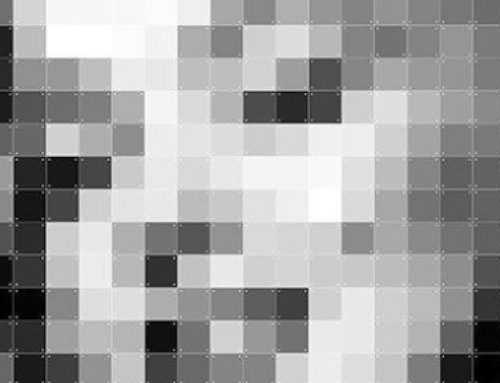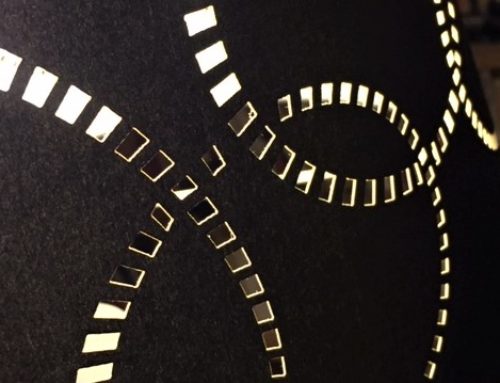On Kawara à l’Oratorio San Ludovico, Venise, été 2017.
La forteresse est en péril. Un traître est hautement suspecté.
Dans ce petit oratorio a été mise en scène l’œuvre de On Kawara One Million Years de 1969, qui consiste en un ensemble de plusieurs volumes de livres remplis uniquement de dates qui précèdent le présent d’un million d’années et lui succèdent d’un million d’années. Ce travail comporte également une part d’oralité et il a souvent été actualisé au cours des années par des performeurs, ici des volontaires par couple, qui ont la tâche de scander ces dates assis à une table. Cette œuvre nous replonge dans les années de l’art conceptuel pur et dur, sec et sans concessions des années 60, celui de Kosuth, Sol LeWitt ou Mel Bochner : ici des chiffres se succèdent sur la page dans un sérialisme strict et austère, un graphisme homogène et régulier, un ordre rigoureux se répétant dans une succession apparemment sans limites, sans irrégularités, sans failles, incorruptible, inattaquable.
Depuis ses nombreuses exécutions, les voix des performeurs ont immanquablement servi et perpétué l’avènement de cet ordre hermétique. Or cette fois-ci, le visiteur découvre les voix dans un chuchotement plutôt faible, intime, qui résonne dans la petite salle de cet édifice religieux désaffecté. L’atmosphère est dominée par la pénombre, de faibles lumières illuminent les deux lecteurs, les épaisses parois de la salle isolent totalement l’endroit du monde extérieur, dans un calme presque mystérieux. En ce huis-clos semi-désert, modeste et isolé, les récitatifs des deux personnages semblent moins institutionnalisés, moins solennels et moins autorisés, et ils se rapprochent du ton de la confession, du murmure secret que l’on avoue à demi-mot, d’un message intime. En ce lieu sombre où la garde est baissée, on peut se permettre de laisser transparaître comme un léger tremblement de la voix, une teinte d’hésitation. Car en écoutant ces récitatifs, on s’aperçoit peu à peu de certains vices de forme qui passent presque inaperçus mais qui se produisent néanmoins : l’un des personnages se racle la gorge au milieu d’une date, ou bien sa voix hésite dans l’articulation des sons, elle tremble, elle bégaie légèrement en causant l’interruption du chiffre et sa reprise, ou bien un intervalle est plus long que les autres entre une date et l’autre parce que l’individu s’arrête pour boire son verre d’eau posé sur la table.
En somme ce discours abstrait et interminable est ponctué, contaminé par tous ces nombreux micro-manquements qui contredisent et opacifient la matérialisation de l’ordre conceptuel pur et immaculé. On observe, à travers l’écoulement du temps réel, une brisure progressive du Concept mental et immatériel par la faiblesse involontaire et les irrégularités du souffle humain. Ce qui crée par conséquent un écart toujours plus large entre une logique théorique de départ et sa réalisation dans un espace contingent nécessairement fragilisée, hésitante par le grain de la voix.
Ce travail est donc révélateur d’un mécanisme qui sous-tend souvent les œuvres de l’art conceptuel à savoir la dissolution progressive de l’Idée à partir du moment où elle se concrétise devant nos yeux et dans notre champ sensoriel accidenté, qui n’est pas en mesure de la soutenir. Dans ce cas précis, ceux-là même qui sont censés incarner le Concept et le rendre vivant – les performeurs – échouent à leur devoir et trahissent une faille dans la planéité rationnelle qui fondait l’œuvre avant sa mise en scène.