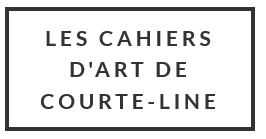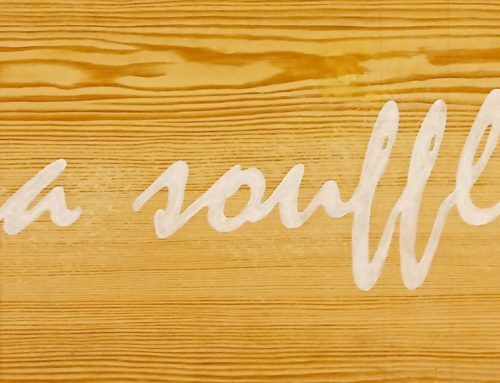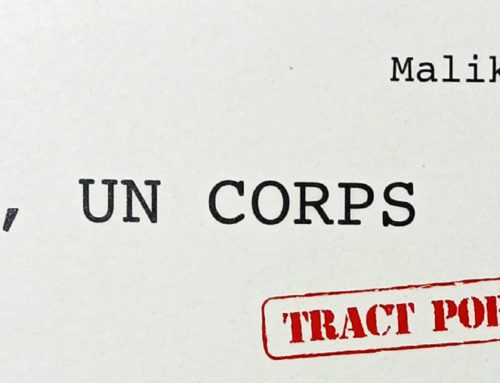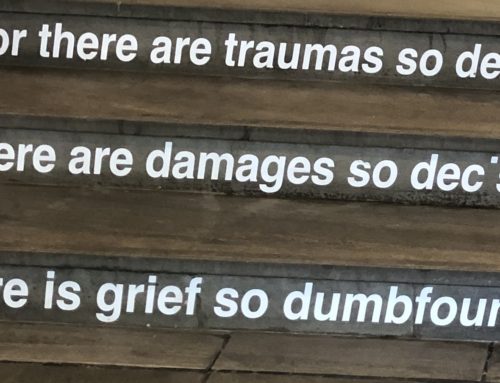Tentative d’introduction à la Documenta 14 par le travail de l’artiste Chryssa.
Dans l’espace du Fridericianum de la Documenta 14 le visiteur fait face au travail de Chryssa dès les premières salles. Cette artiste grecque présente en particulier deux travaux qui questionnent l’accès à la parole. Notons préliminairement le choix des curators d’exposer ces installations qui d’une part assument la fonction d’ouvrir le bal ; et qui d’autre part ne sont pas toutes récentes puisqu’elles datent des années 60. Il s’agit de Cycladic Books de 1957 et de Newspaper Book 1962.
Le premier travail comporte sous une vitrine longiligne des formes rectangulaires irrégulières aux surfaces géométriques entièrement blanches. Nous ne pouvons identifier ce type d’objet qu’après avoir lu sur le cartel que ces « livres » sont réalisés par le moulage interne d’emballages en carton.
Le second se présente sous la forme d’un vaste journal dont on peut tourner les pages, accroché au mur à la verticale par son arête. Les pages sont sous verre et encadrées par une lamelle de métal. De loin le spectateur associe ces pages à des feuilles de journal par la mise en page soignée de l’écriture. En s’approchant il s’aperçoit du leurre : les pages inscrites au crayon ne reproduisent qu’un gribouillis de petits traits qui se répètent, mimant la forme d’un article de journal d’une colonne, avec un petit espace rectangulaire laissé libre pour l’image (absente). Ces colonnes d’articles se répètent en grille à l’identique sur un mode neutre et anesthésié, gris sur blanc, toujours dans une esthétique cycladique semble-t-il, une touche de tradition locale à première vue tout à fait jolie et très discrète : formes simples, modestes, prédominance du blanc.
Ainsi ces œuvres, placées au seuil du parcours de l’exposition, sont censées ouvrir sur une parole, fournir au spectateur un accès à un message verbal qui puisse le conduire et l’introduire au discours de l’expo. Or cette parole, aussitôt qu’elle est inaugurée par la spécificité de ces travaux, est aussitôt niée. En quelque sorte le premier contact du spectateur avec le lieu advient au travers d’une parole avortée.
Concernant la série des « livres cycladiques » cet objet, réceptacle indéniable de la parole écrite, est pourtant dépossédé de sa substance, réduit à une coquille vide, ou plutôt pleine, compte tenu de la matière du moule. Car l’artiste a ici échangé le contenant avec le contenu : l’emballage creux qui normalement enveloppe le livre se remplit, s’opacifie et se solidifie dans l’objet qu’il renfermait. Ces simulacres de livres de forme vaguement rectangulaire, déstructurée par les plis de l’emballage, ne renvoient à rien d’autre qu’à leur surface uniformément blanche, telles des demeures scellées à demeure, faux témoignages d’un discours rêvé et fantasmatique. Ainsi ces formes blanches, censées renvoyer par leur couleur au blanc des petites maisons grecques typiques, baignées dans la lumière du soleil, se lisent plutôt comme des tombeaux pour la parole.
Cette simulation du verbe se produit également avec le « Newspaper Book » : le journal par définition nous fournit les dernières infos fraiches d’impression. En outre la mise en page suggérait au premier abord la formation d’un message qui, considération faite du contexte où l’œuvre prend place, pouvait logiquement constituer une introduction plus ou moins indirecte au discours plus ample de l’expo. Mais cette impression de familiarité avec l’objet s’évanouit, non seulement par l’absence totale du mot de la feuille, mais aussi par la date de l’œuvre : un journal de 1962, pas tout à fait à jour en effet. Ce journal se révèle tout à coup comme un objet inquiétant qui par ses inscriptions si rigidement cadrées et ordonnées, nous impose un rappel à l’ordre, nous intime une discipline subreptice du geste scriptural qui censure et exclut la possibilité du mot, en dispersant le trait de cette écriture fallacieuse à la surface du papier.
En somme des effets de surface, et des effets vitrine car les deux travaux, les livres tout comme les pages de journal, gisent derrière une vitre qui sanctionne une muséification de la parole, murée et donc stérile dans les limites d’un enclos splendide et transparent.
Le décalage chronologique auquel nous faisons face est symptomatique de ce retour du refoulé : ces œuvres conçues au milieu du siècle dernier puis oubliées, rejaillissent soixante ans plus tard comme pour satisfaire une urgence actuelle de l’utilisation de la parole, cette parole laissée en suspens, affichée mais jamais déchiffrée. Ces œuvres témoignent d’un désir d’accès au mot, de faire entendre la voix d’une parole, qui demeure irrésolu.
A ce titre un sens politique se niche dans ce travail, que l’on peut traduire par un certain rapport de force qui s’est établi dans l’histoire de l’art contemporain entre les artistes en fonction d’une géographie abusive qui a longtemps privilégié, et qui continue de le faire encore aujourd’hui, le modèle d’artistes d’Europe de l’Ouest ou nord-américains. Or cette Documenta prend le parti de réfuter cette hégémonie d’une histoire de l’art occidentalo-centrée en exposant un nombre considérable d’artistes grecs en collaboration avec le Musée d’art contemporain d’Athènes, artistes notables et presque complètement ignorés du public occidental.
Le spectateur, remettant en question l’objectivité de son savoir sur l’histoire de l’art récent, se heurte véritablement à ce nouvel éloge de l’ombre.