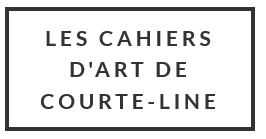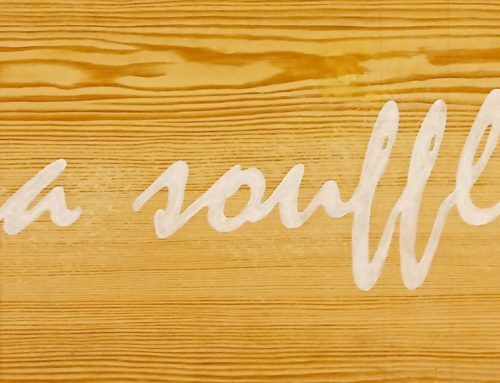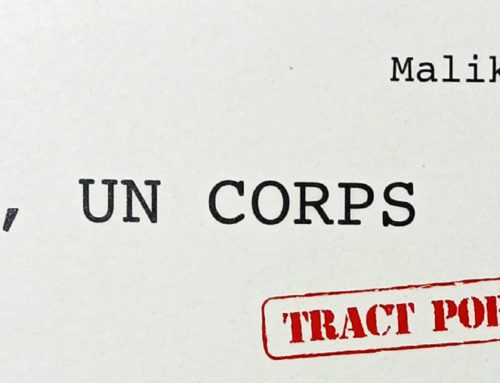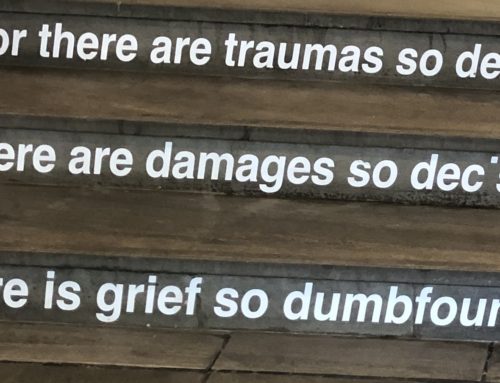Compte rendu d’exposition
« Périurbaine pastorale » à la galerie Tokonoma, Paris
14 novembre – 7 décembre 2019
L’expo « Périurbaine pastorale » s’ouvre ce 14 novembre à la galerie Tokonoma, et présente deux artistes, Fred Maillard et Philippe Caillaud, qui mettent en jeu l’idée de paysage pour la malmener à plusieurs niveaux de sens. Alors que F. Maillard nous offre la vision d’une France périurbaine dans un contrepied moqueur de son image d’Epinal, P. Caillaud enferme notamment le paysage dans son paradigme touristique standardisé, par les calembours visuels de ses « Guides verts obsolètes ».
Emblématique (c’est le cas de le dire) de cette exposition est la série des « 24 Blasons » de Fred Maillard, qui joue d’un décalage entre le texte, l’image et le symbole. Ces trois réalités sont télescopées les unes sur les autres à la surface de ces peintures – exposées en grille – chacune exerçant sur les autres un effet de distorsion. Les vues naturelles esquissées que nous regardons sont tout ce qu’il y a de plus banal et d’insignifiant : des paysages génériques, évidés, simplifiés à l’essentiel, où se mêlent à la nature des traces de civilisation humaine. Des chaises en plastique empilées, une clôture de jardin avec grillage, une barrière au bord de la route, des pavillons de banlieue, etc. D’autre part nous voyons en grand format des noms de provinces françaises, qui font irruption au milieu de ces paysages et modifient la fonction de l’image : tout d’un coup ce paysage anodin est censé incarner le symbole d’une région, ce qui la caractérise et la valorise, puisqu’il s’agit de « blasons ». Ainsi la haute valeur symbolique du blason évoquant la dignité du territoire français, contraste avec la trivialité du paysage qui en est le miroir.
Dans cette « esthétique de la déception », chaque élément de l’image vient appauvrir les autres, provoque un court-circuit du message : le paysage vient priver le blason de tout son sens politique et symbolique, le réduisant à un simple slogan publicitaire. Le nom propre, quant à lui, ne fait que renvoyer à son inanité même, à l’absurdité qu’il y aurait à tenter seulement de penser la gloire d’une « francéité », dont nous ne pouvons que constater l’image dérisoire et ironique sous nos yeux. Cette série des 24 blasons cherche à « réduire la capacité de séduction de l’art jusqu’à un point de dissolution[1] », un « vanishing point », comme le disait le critique Harold Rosenberg dans les années 70 à propos de tendances manifestant une « pauvreté » dans l’esthétisation de l’objet.
Nous retrouvons ce goût pour le banal et l’anecdotique dans les séries de Philippe Caillaud exposées ici, « Guides Verts » et « Incendies ». Dans la première toute référence au territoire naturel est aseptisée et standardisée dans des « guides obsolètes » pour touristes, exposés uniformément là encore selon le mode de la grille, sur lesquels l’idée de paysage est évoquée par des esquisses humoristiques, rappelant le dessin animé pour enfants, accompagnées de titres moqueurs. Des lieux qui ont tous en commun le fait d’être inaccessibles, paradoxaux et qui sont simplement les pièges de nos jeux de langage. Dans la seconde série le thème de la catastrophe naturelle est dépourvu de toute emphase car transformé en un simple geste décoratif, dessiné format réduit sur des boîtes d’allumettes – gadgets que l’on peut trouver dans les boutiques de souvenirs – elles-mêmes disposées dans un mode sériel et répétitif. Dans les deux cas la référence à la nature est prise dans ce même processus de « dé-esthétisation[2] » (Rosenberg) où le geste conceptuel de l’artiste, c’est-à-dire la mise en scène sérielle et minimale, vient presque effacer la valeur figurative des illustrations.
Liens vers les images :
Fred Maillard : https://galerie-tokonoma.fr/24b_diapo_02/
Philippe Caillaud : https://philippecaillaud.com/artwork/guides-verts-2/guides-verts/
[1]Harold Rosenberg, « De-Aestheticization [1970] », dans Gregory Battcock (dir.), The New Art, New York, E. P. Dutton, 1973, p. 184 (traduction par nos soins).
[2]Ibid., p. 178.