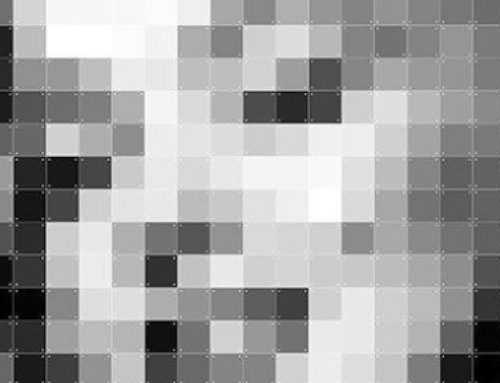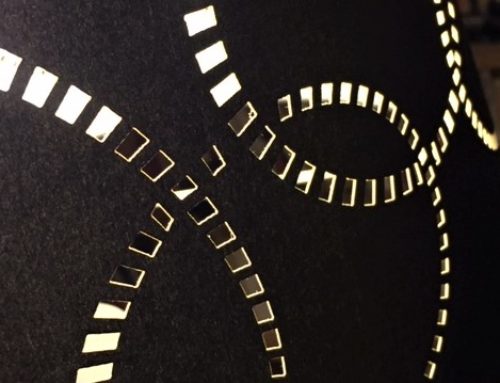A l’occasion de la Manifesta 14 qui s’est terminée le 30 octobre dernier, la ville de Prishtina, qui oscille habituellement
entre un post-stalinisme désavoué et une américanophilie partout affichée (statue de Clinton et avenue George Bush à
l’appui), deux idéologies qui ont comme points communs la grisaille austère de l’urbanisme, l’intense pollution de l’air
qui nous accompagne tout au long de la visite de la biennale ainsi que le consumérisme glamour qui s’empare comme de
coutume de toutes les villes en voie de dé-stalinisation accélérée et simultanément de clintonisation précoce mais non
encore parfaitement assimilée, cette ville du Kosovo donc, s’est transformée en une ville-musée.
D’un point de vue purement spectatoriel, le parti pris de la commissaire Hedwig Fijen était d’avoir donné une
importance toute particulière à l‘effet de scénographie pour ainsi dire prêt à l’emploi, ou prêt-à-porter (pour rester dans
une perspective clintonienne) que la ville elle-même dégage sans qu’on ait besoin d’y toucher. Le site principal de l’expo
se tenait dans le « Grand Hôtel Prishtina », très imposant bâtiment de 9 étages immenses (32000 m2), ancien hôtel cinq
étoiles du temps de la Yougoslavie et qui est à demi vétuste aujourd’hui, après avoir été le théâtre de violences et de
répressions pendant la guerre de 90. Quand on circulait dans ses couloirs sans fin, on était plongé dans une ambiance
décadente à la Edward Kienholz, papiers peints et moquettes velours kitsch, chambres évidées et à moitié détruites (1%
des chambres est encore utilisé!), et, par moments, « en passant », les oeuvres çà et là paraissaient presque s’effacer dans
un décor aussi chargé. Chose curieuse mais significative : l’accrochage occupait une partie réduite de chaque étage, de
sorte qu’au moins 50 % du parcours consistait simplement pour les visiteurs à déambuler dans les couloirs de l’hôtel aux
multiples portes (qu’on pouvait ouvrir mais qui ne menaient à rien ou ne donnaient sur « rien »), s’attendant à tomber sur
une oeuvre à chaque détour. De la pure scénographie sans oeuvre. Pour ne citer qu’un autre exemple parmi les nombreux
sites tombés en désuétude et réhabilités pour l’expo, prenons l’usine de briques à la périphérie de la ville : on arrive,
personne. Le lieu est immense, désert. On aperçoit quand même deux médiatrices cachées entre les murs de briques. On
leur demande de nous renseigner, elles ne parlent pas l’anglais, elles ne savent pas, nous font des gestes vagues. Des
bâtisses industrielles en ruine dans lesquelles on peut entrer : on passe dans les différentes salles vides et délaissées. On
essaye quand même de garder l’attitude de déférence et de gravité nécessaire à toute appréhension de l’art contemporain
qui se respecte, mais sans voir aucune oeuvre. (« Tarkovski » n’est pas loin). Parfois des inscriptions aux murs ou un
agencement de formes pourraient nous faire penser à un travail d’artiste, notre oeil étant toujours déjà prêt à accueillir
n’importe quel soupçon d’« art ». A un moment donné on pousse une porte, on tombe sur une immense décharge qui
sature l’espace de 500 m2, notre esprit bien dressé nous fait tout de suite inventer un possible remake ou hommage
monumental au Plein d’Arman. Des chiens errants surgissent de derrière les déchets et aboient en notre direction. On
fait demi-tour. En revenant sur nos pas on trouve enfin l’installation centrale faite de vieux sacs de jute qui se mimétise
parfaitement dans le décor, grâce au panneau vert officiel de la Manifesta. Constat qui nous surprend le plus : l’oeuvre
en question occupe l’équivalent mettons de 0,5 % de l’espace de la « mise en scène ». Démesure absolue entre l’oeuvre
et son lieu d’exposition. La commissaire est ainsi à l’origine de cette méta-oeuvre où la mise en scène (ou des portions
entières de celle-ci) n’a pas besoin d’abriter un quelconque travail puisqu’elle est elle-même oeuvre d’art, elle se suffit à
elle-même.
Si avec le ready-made de Duchamp, l’Art a dévoilé sans filtres son discours de vérité par définition inquestionnable
(l’oeuvre est ce qui est, c’est-à-dire un pur principe d’identité à soi, sans besoin d’une justification quelconque),
aujourd’hui ce discours, qui n’aura jamais été aussi puissant, est en mesure de délimiter arbitrairement de vastes portions
de territoire comme « Art », c’est-à-dire comme participant du Vrai, de l’Authentique, de ce que l’Homme accomplit, de
la Civilisation. La civilisation humaine n’aura jamais été aussi Vraie qu’aujourd’hui. Piero Manzoni en 1960 avait déjà
tiré les conséquences de la nature de l’institution qui s’est appelée Histoire de l’art, avec son oeuvre Socle du monde : la
Terre entière s’artifie telle quelle, par la simple autorité de l’artiste. Si tout peut être art, l’oeuvre d’art paraît finalement
inutile, devenant un pléonasme ou une aporie, parce qu’elle vient illustrer un principe qui n’a pas besoin d’être
« illustré » ou « prouvé », celui de la vérité à soi. L’Art n’est peut-être pas autre chose que l’un des grands discours
métaphysiques de l’Occident, l’autre visage de l’onto-théologie.